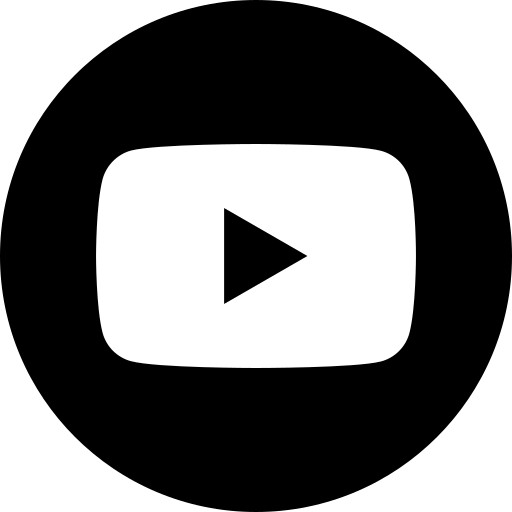Fondations en maçonnerie de pierres
Pierre Lacroix ingénieur, spécialiste en matériaux
Premier d’une série d’articles sur les modes de construction et les matériaux, préparés par des membres du Groupe-conseil de l’APMAQ. Ces articles visent l’amélioration des connaissances afin de permettre à nos membres et au public d’avoir une meilleure compréhension des besoins de conservation du bâti.
Mise en situation
Bâtir sur du solide, bien asseoir sa maison sur des fondations et bien l’orienter fut une préoccupation constante des colons venus au pays. La proximité des ressources a dicté l’usage du bois et de la pierre.
Rappel historique
 Au début de la colonisation, le carré de bois s’élèvera à partir de grosses lambourdes posées directement sur un lit de pierres sèches à même le sol ferme. Cette technique peut être observée sur un bon nombre de granges et de remises anciennes (photo 1).
Au début de la colonisation, le carré de bois s’élèvera à partir de grosses lambourdes posées directement sur un lit de pierres sèches à même le sol ferme. Cette technique peut être observée sur un bon nombre de granges et de remises anciennes (photo 1).
 Dès le XVIIe siècle, les fondations seront en maçonnerie de pierres des champs (ou moellons) (photo 2). La nature de la pierre est en relation avec le socle rocheux et l’histoire géologique la plus récente soit la dernière glaciation. Soulignons que le Québec se divise en trois grandes zones géologiques : le Bouclier canadien, la Plate-forme du Saint-Laurent et les Appalaches.
Dès le XVIIe siècle, les fondations seront en maçonnerie de pierres des champs (ou moellons) (photo 2). La nature de la pierre est en relation avec le socle rocheux et l’histoire géologique la plus récente soit la dernière glaciation. Soulignons que le Québec se divise en trois grandes zones géologiques : le Bouclier canadien, la Plate-forme du Saint-Laurent et les Appalaches.
Les pierres qui composeront la maçonnerie doivent être soigneusement assises suivant son lit ou sa structure, stabilisées à l’aide de cales, empilées et intégrées afin que les murs puissent se tenir sans l’aide de mortier, ce dernier, à base de chaux éteinte et de sable ayant une fonction de bouche-trou.
Au cours du XIXe siècle l’industrialisation procurera des ciments naturels qui seront principalement présents dans la construction de bâtiments institutionnels et d’infrastructures de transport. Le développement et la distribution du ciment Portland dès 1890 auront comme effet que des mortiers à base de chaux pourront contenir une proportion de ce ciment Portland, plus particulièrement dans le cas de maçonneries de bâtiments institutionnels au tournant du XXe siècle (1890-1910).
La pierre peut provenir des sols ou du roc affleurant et, dès le XVIIe siècle, on commencera à ouvrir des carrières à proximité des grands centres, lesquelles exploiteront principalement des lits ou strates de calcaire (photos 3, 4 et 5).



La technologie de production de la chaux est déjà bien connue et accessible au début de la colonisation. Ce liant de maçonnerie sera appelé chaux commune ou chaux grasse dans la région de Québec, tandis qu’il sera principalement qualifié de chaux hydraulique (chaux maigre) sur l’île de Montréal. Considérant la présence de dolomite dans des strates calcaires, un calcaire magnésien, de la chaux magnésienne a sûrement été produite dans la région de Montréal. Des recherches restent à faire.
Pourquoi faire ou non une intervention?
Le mortier de chaux a une faible résistance mécanique en compression et est peu durable face aux cycles de gel et de dégel en présence d’eau. Ce sera là la première cause du besoin d’une intervention. D’ailleurs, le point de rencontre de la maçonnerie avec la ligne de sol et les premiers 450 à 600 mm (1 ½ - 2 pi) sous le niveau du sol seront généralement les plus dégradés et leur état doit être évalué par des sondages. C’est là où le mortier se présente sous forme de sable que l’on doit intervenir.
Les fondations peuvent être une source de tracas, encore plus avec les perturbations au fil des siècles et des désordres qui pourraient s’être développés à la suite d’agrandissement, de sur-excavation, d’une surisolation intérieure, de la densification du parc immobilier, du rabattement de la nappe et de l’assèchement des argiles. Ces désordres nécessiteront des interventions pour des joints dégradés, des lézardes, des dégradations de pierres de la maçonnerie, des déformations de la maçonnerie ou des dislocations d’éléments de maçonnerie (associées au gel).
Comment bien intervenir
Le mortier de chaux ne peut être évalué avec un couteau ; d’ailleurs la résistance de la maçonnerie n’est pas celle du mortier mais celle de l’assemblage des pierres. Un mauvais assemblage ou des pierres de plus faible durabilité aux cycles de gel et de dégel pourront occasionner des bombements.
Il faut d’abord reconnaître la cause des désordres au moyen d’une bonne inspection effectuée par un professionnel.
Rappelons que l’on ne doit pas isoler complètement les fondations de maçonnerie par l’intérieur, au risque d’avoir du gel dans un mortier saturé, sauf s’il y a eu imperméabilisation de la maçonnerie par l’extérieur, sous le niveau du sol fini. Et on se doit d’évaluer le besoin d’une imperméabilisation et du drainage des fondations ; mais est-ce une obligation, c’est loin d’être toujours le cas.
Bonne pratique à adopter
Pour les fondations, pour le démontage et le remontage localement comme pour le rejointoiement de la maçonnerie, un mortier d’une résistance comparable au mortier existant est requis. Un mortier à base de chaux, de type O, est alors recommandé. Compte tenu de la consistance requise pour ces travaux, ce mortier se comparera à un mortier de type N, suggéré pour utilisation dans le cas de maçonnerie soumise aux intempéries.
Un mortier de chaux, d’une résistance en compression comparable au mortier de type O peut se qualifier par le martelage de clous réguliers de 63 à 75 mm de longueur dans des joints de la maçonnerie. Si les clous peuvent être enfoncés sans se tordre, le mortier se compare à un mortier de substitution de type O ; si les clous se tordent après un enfoncement de quelques millimètres, le mortier en place se comparera à un mortier de type N ou de résistance supérieure et un mortier de type N sera à valider. Attention de ne pas réaliser les essais de martelage sur des mortiers de rejointoiement!
 Ces mortiers sont disponibles pré-ensachés, il est aussi possible de produire soi-même son mortier à base de chaux, de ciment, de sable à maçonnerie et d’eau. Tout rejointoiement doit être réalisé sur une profondeur minimale de 20 mm, soit environ deux fois la largeur du joint et jusqu’à retirer le mortier désagrégé se présentant sous la forme d’un sable. Le dégarnissage des joints se fera avec des outils manuels ou mécaniques légers, de moins de 7 kg en masse, sans briser les arêtes des pierres.
Ces mortiers sont disponibles pré-ensachés, il est aussi possible de produire soi-même son mortier à base de chaux, de ciment, de sable à maçonnerie et d’eau. Tout rejointoiement doit être réalisé sur une profondeur minimale de 20 mm, soit environ deux fois la largeur du joint et jusqu’à retirer le mortier désagrégé se présentant sous la forme d’un sable. Le dégarnissage des joints se fera avec des outils manuels ou mécaniques légers, de moins de 7 kg en masse, sans briser les arêtes des pierres.
Il est possible de trouver de la pierre de remplacement dans les rares centres de récupération, sur le terrain du bâtiment, dans les fossés et les excavations environnantes. Concernant la pierre de taille, les nouvelles pierres se distingueront, par leur teinte, des pierres initiales car de nombreuses années sont requises pour retrouver la même teinte d’altération (photo 6). Il est difficile de reproduire les teintes d’altération des pierres calcaires. Dans la mesure du possible, si une intervention n’est pas associée à leur contenu argileux (laminés et lits de shale) elles seront réparées par collage époxydique et avec l’utilisation d’ancrages ou de goujons, surtout pour les cadrages des ouvertures (fenêtres et portes).
Référence
St-Louis, Denis (1984) Maçonnerie traditionnelle, Région de Montréal et de Québec, Volume II, Héritage Montréal, 245 pages plus suppléments
Lexique
Chaux : Produit obtenu de la calcination (de la décarbonatation) d’un calcaire par chauffage à haute température, à environ 900°C, permettant l’expulsion de gaz carbonique (CO2).
Chaux vive : Le produit de la calcination de la pierre calcaire, l’oxyde de calcium (CaO).
Chaux éteinte/Chaux hydratée : Obtenue après la réaction complète de la chaux vive (CaO) avec une quantité d’eau (H2O), (Ca(OH)2).
Carbonatation : L’action du gaz carbonique (CO2) dans l’air sur la chaux éteinte pour reformer le calcaire.
Chaux aérienne : Chaux provenant de calcaire pur à relativement pur dont la prise, par carbonatation, se fait à l’air, mais qui ne durcit pas dans l’eau. La chaux aérienne peut être qualifiée de grasse ou de maigre.
Chaux grasse (aussi appelée commune): Chaux produite à partir de bancs très purs de calcaire, exempts de lits ou laminés de shale, moins de 1 % de matériau argileux.
Chaux maigre : Chaux produite à partir de calcaire impur (légèrement argileux) et/ou de lits de calcaire interlités de couches de shale, contenant moins de 5 à 8 % de matériau argileux.
Article tiré de La Lucarne – Été 2024 (Vol XLV, numéro 3).
© APMAQ 2024. Tous droits réservés sur l’ensemble de cette page. On peut reproduire et citer de courts extraits du texte à la condition d’en indiquer l’auteur et la source, mais on doit adresser au secrétariat de l’APMAQ toute demande de reproduction de photos ou du texte intégral de cette page.
Retour


.png)