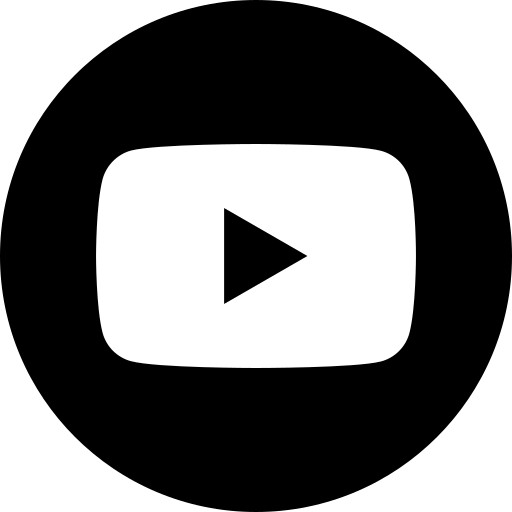Les finis architecturaux, fragments de mémoire du patrimoine
Isabelle Paradis
Restauratrice de biens culturels, spécialisée dans les finis architecturaux et récipiendaire du Prix Robert-Lionel-Séguin 2023
|
Lors de la restauration d’une maison ancienne, on cherche habituellement à comprendre et à retrouver son aspect ancien et, si possible, celui d’origine. À l’image d’une enquête où les indices sont des traces de peinture, des fragments d’enduit ou encore du papier peint, le décor se dévoile comme un jeu de piste lors de l’examen des finis architecturaux. Quel type de finition était présent sur les lambris de bois, y avait-il une finition sur la maçonnerie, quels types de peinture ou de couleurs étaient utilisés pour réaliser les décors anciens ? L’étude des finis permet de répondre à certaines questions lorsque des fragments de peintures anciennes sont encore présents, et ce, même sous forme de minuscules traces. Ces témoins sont des mines d’information pour qui sait les interpréter. Ils peuvent révéler des détails très précis sur le type de finition, sur la période du décor et parfois sur le statut des anciens propriétaires. La méthode utilisée est un relevé fait sous la forme de sondage à l’aide de scalpel et de loupe grossissante. Les couches de peinture sont dégagées une à une afin de comprendre l’évolution du décor (photo 1). Parallèlement à ces sondages, de petits échantillons de peinture sont prélevés sur chaque élément de la pièce pour être mis en résine afin d’être observés au microscope sous forme de coupe stratigraphique (photo 2). Le microscope comme machine à remonter le tempsL’examen au microscope est l’étape qui permet de voir, en une seule image, toutes les couches de peinture des différentes époques accumulées au fil du temps. C’est comme si l’histoire de la maison défilait sous nos yeux à travers les couches de peinture. Des analyses scientifiques plus poussées peuvent apporter encore plus d’information sur l’identification des pigments et des liants des peintures. Certains pigments sont comme des jalons dans les couches de peinture. Par exemple, la date d’invention de pigments comme le jaune Turner, le vert émeraude ou le blanc de titane, peut permettre d’établir la période de la couche dans laquelle il se trouve. Les coupes stratigraphiques de peinture peuvent être étudiées et analysées en profondeur, mais sans l’étude préalable des archives, l’interprétation des résultats demeure partielle. Le contexte de la maison doit être mis en trame de fond pour que le restaurateur puisse faire une interprétation des différentes époques qui s’y sont succédé. D’autres caractéristiques techniques du bâti, comme le mode d’assemblage, le type de quincaillerie utilisé et la présence de certains matériaux peuvent aider à interpréter ou à dater les modifications. Avec toutes ces informations et des connaissances approfondies des techniques et des matériaux anciens, il est possible d’avoir un portrait détaillé des différents états de la maison au fil du temps. Rares exemples à l’île d’OrléansL’île d’Orléans est bien connue pour la richesse de son patrimoine bâti et pour la transmission de certaines techniques de construction qui ont perduré un peu plus longtemps qu’ailleurs, notamment en raison de son caractère rural et insulaire. Malgré cela, très peu d’intérieurs ont conservé des traces de leurs finitions d’origine. Les « curetages » souvent drastiques ont fait bien des ravages, lesquels ont effacé presque toutes les traces du passé; pourtant, quelques-unes subsistent. La maison Pichet-Gosselin est un exemple où plusieurs éléments du décor ancien ont été conservés derrière les revêtements modernes. Lors des travaux, l’examen des échantillons de peinture a permis d’identifier plus d’une quinzaine de couches de peinture sur les cloisons de bois de la salle à manger (photo 3). Cet examen a permis de reconstituer une des teintes les plus anciennes de la pièce, un vert foncé à base de bleu Outremer et d’ocre jaune (photo 4). On a également mis à jour et restauré l’enduit de chaux posé sur lattis toujours présent sur le carré de pièce sur pièce du début du XIXe siècle (photo 5). Des traces de couleur ocre rouge ont également été trouvées et documentées dans le salon (photo 6). Selon la tradition orale, ce salon a longtemps été réservé aux visites du curé. Est-ce que la couleur rouge aurait servi à donner un caractère plus prestigieux à la pièce ? D’autres éléments de décors ont été retrouvés dans des intérieurs comme à la maison Lachance à Saint-Laurent. Les murs d’enduit de chaux de la salle à manger étaient ornés de motifs verts faits au pochoir (photo 7). Les propriétaires ont même retrouvé le contrat du peintre décorateur daté de 1837, année de la construction de la maison. Un autre exemple de décor examiné dans un intérieur est celui de la maison Aubin à Saint-Pierre. Des motifs peints à la main sur le plancher de la pièce principale ont été découverts lors de travaux, autant d’éléments décoratifs qui illustrent le souci du détail même dans l’intérieur humble d’une maison de ferme (photo 8). La couleur comme empreinte du tempsContrairement à ce que l’on peut croire, la finition des murs de lambris de bois ou de maçonnerie était une pratique quasi systématique dans les maisons anciennes. Les maçonneries laissées avec les pierres apparentes ou les planches de bois décapées sont l’expression d’une mode récente, sans lien avec la réalité du passé. Anciennement, le revêtement peint des murs faisait partie intégrante des intérieurs. La finition avec des peintures à l’huile, à la colle animale, au lait (caséine) ou à la chaux (badigeon) était essentielle pour qu’un intérieur soit considéré comme achevé. Le chaulage faisait partie de la routine d’entretien d’une maison. Cependant, une distinction est à faire avec les maisons de colonisation, dont les intérieurs étaient souvent laissés au matériau brut en raison de leur fonction temporaire. Nos ancêtres ne vivaient pas dans des intérieurs laissés aux matériaux bruts, en particulier à partir du XIXe siècle. L’industrialisation a favorisé la production des peintures bon marché et leur distribution à grande échelle. D’ailleurs, l’invention de la peinture vendue en pot à la fin du XIXe siècle a participé à cet essor. L’exemple du pigment bleu Outremer qui apparaît en 1830 et qui sera utilisé à grande échelle pour blanchir les papiers et les tissus (c’est le bleu à laver de nos grands-mères) est représentatif. Dès lors, la couleur bleue se démocratise, tout le monde peut colorer son intérieur car la couleur n’est plus réservée aux gens fortunés. Les teintes vives et pures deviennent accessibles pour la décoration et le goût prononcé pour la couleur va se répandre comme une traînée non pas de poudre, mais de pigments ! Si l’on tient également compte de la mode des papiers peints aux motifs parfois imposants ou fantaisistes, certains intérieurs anciens peuvent nous apparaître assez surprenants, voire excentriques. Les décors qui ornent les intérieurs sont à l’image de la mode de l’époque, mais aussi de la personnalité des propriétaires. Différents styles circulent, on s’inspire des motifs des textiles ou des objets décoratifs à la mode que l’on reproduits pour décorer son intérieur. Parfois ce sont aussi de véritables créations qui ornent les murs ou les planchers. On aime les aménagements colorés, tant dans les demeures opulentes des grands centres qu’au fin fond des campagnes. L’avancement des connaissances sur le patrimoine bâtiLes couches de finition des intérieurs sont des traces inestimables du passé du patrimoine bâti. L’étude de ces traces contribue à l’avancement des connaissances, ce qui permet une meilleure compréhension de l’histoire décorative, architecturale et sociale des bâtiments. Certains aspects de notre patrimoine bâti sont encore méconnus, par exemple, l’origine des matériaux. L’étude et la mise en valeur des intérieurs anciens participent à une meilleure compréhension de notre patrimoine et de notre culture. Quand on y regarde de plus près, la couleur n’a pas seulement une fonction décorative en architecture, elle occupe aussi une fonction culturelle, comme un marqueur social. Elle tisse également des liens intimes avec notre mémoire et nos émotions. |
|
Article tiré de La Lucarne – Printemps 2024 (Vol XLV, numéro 2).
© APMAQ 2024. Tous droits réservés sur l’ensemble de cette page. On peut reproduire et citer de courts extraits du texte à la condition d’en indiquer l’auteur et la source, mais on doit adresser au secrétariat de l’APMAQ toute demande de reproduction de photos ou du texte intégral de cette page.
Retour






.png)