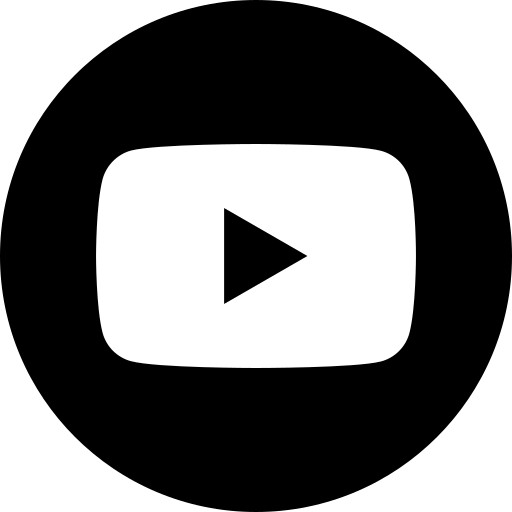Fondation en béton de ciment
Pierre Lacroix, ing. M. Ing., spécialiste en matériaux et membre du Groupe-conseil
Second d’une série d’articles sur les modes de construction et les matériaux, préparés par des membres du Groupe-conseil de l’APMAQ, ceux-ci visant l’amélioration des connaissances afin de permettre à nos membres et au public d’avoir une meilleure compréhension des besoins de conservation du bâti. Retrouvez le premier article ici.
Mise en situation
 Photo 1 : Mur dans la Rome antique constitué de pierres et de briques reliées par un mortier de chaux et de cendres volcaniques appelé « béton romain ».
Photo 1 : Mur dans la Rome antique constitué de pierres et de briques reliées par un mortier de chaux et de cendres volcaniques appelé « béton romain ».
Contrairement à l’emploi courant de la chaux dans la maçonnerie qui a des siècles d’utilisation soit depuis environ 2000 av. J.-C., le béton est un matériau récent avec à peine un peu plus de 100 ans d’usage.
De nos jours, une durée de vie supérieure à 150 ans pour un béton régulier est attendue. Toutefois, le béton d’hier et d’aujourd’hui peut présenter des désordres reliés à sa composition, à sa mise en place, à sa cure (plutôt à son absence de cure), à son hydrofugation*, à son retrait de séchage, à l’absence d’armature, à la mise en place sur une assise impropre ou remaniée et plus encore à l’action des cycles de gel et dégel et de réactions entre le ciment et les granulats. Pour toutes ces raisons, il est pertinent de s’attarder au béton de ciment des fondations.
Rappel historique
Le passage de la fabrication de la chaux à celle des ciments naturels résultant de la calcination d’un mélange de calcaire et d’argile, puis à celle des ciments Portland s’est faite progressivement du milieu du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle à partir d’études que l’on peut qualifier de scientifiques, au hasard de développements techniques heureux et aussi avec une grande part de chance. Le nom ciment Portland provient d’un brevet obtenu en 1824 par le britannique Joseph Aspdin, pour la découverte d’un ciment amélioré qui une fois durci avait la couleur des pierres de l’île de Portland (Angleterre). Il faut cependant attendre aux environs de 1850 pour que son fils William réussisse à le fabriquer, en élevant suffisamment la température de cuisson d’une combinaison de calcaire et de shale (argile consolidée) afin d’obtenir les proportions souhaitées de silice, d’alumine et de fer que devait contenir une pierre calcaire pour produire un ciment Portland.
La première exportation de ciment Portland britannique vers les États-Unis date de 1871. Ce n’est qu’entre 1890 et 1899 que la production de ciment Portland dépassa la production de ciment naturel aux États-Unis, qui devient marginale en 1900 (2 % de la production). C’est tout juste avant 1900 que les fours rotatifs commencèrent à remplacer les fours verticaux et qu’apparurent les premiers broyeurs à boulet d’acier. Dans les mêmes années, l’ajout de gypse lors du broyage du clinker* débuta afin de contrôler la prise.
Comme mentionné précédemment, l’arrivée du ciment Portland sur le marché commercial se situe au début des années 1870. Il est largement distribué dans les années 1890 et il est couramment utilisé pour la réalisation des fondations dès les années 1900-1910. En 1889 au Canada, le ciment Portland est produit aux usines de Montréal et de Hull, (aujourd’hui Gatineau). Elles sont une vingtaine en 1909, toutes situées en Ontario et au Québec.
Le béton régulier utilisé actuellement se compose de ciment Portland, de granulat fin (sable), de gros granulat (concassé ou naturel), d’eau et d’adjuvants. Les ajouts cimentaires sont étudiés et incorporés dans certains bétons à partir des années 1970, mais ils sont rarement utilisés dans la fabrication du béton de fondations résidentielles. Un ajout cimentaire est un matériau généralement plus fin que le ciment et qui possède des caractéristiques hydrauliques ou pouzzolaniques* (réaction avec la chaux d’hydratation du ciment) ou les deux, lui permettant d’être utilisé en remplacement du ciment Portland tout en améliorant diverses propriétés du béton.
 Photo 2 : Bétonnière London, tout début XXe siècle, ancêtre des bétonnières d’aujourd’hui, Site historique national de Paspébiac, Gaspésie.
Photo 2 : Bétonnière London, tout début XXe siècle, ancêtre des bétonnières d’aujourd’hui, Site historique national de Paspébiac, Gaspésie.
La livraison par bétonnière à tambour ne débute qu’au milieu du XXe siècle. Précédemment, le béton était malaxé sur place avec une petite bétonnière à tambour comme celles qui sont toujours disponibles dans les centres de location.
Jusqu’au milieu du XXe siècle, les granulats sont considérés des matériaux inertes de remplissage. Cependant, les granulats doivent être exempts de matières pouvant entraver le lien pâte/granulat, ce qui comprend la matière organique, le charbon et l’argile. On peut donc retrouver en plus des constituants de base dans le béton, de la brique, des scories de bouilloire (mâchefer), du bois et des cailloux. Ces derniers peuvent constituer des horizons dans le béton ou le plus souvent être jetés même garochés dans ce dernier.
Dans les premiers usages du béton en fondation, une résistance à la compression sur cylindre de 1000 lb/po² (7 MPa) était attendue. Les premières exigences sur le béton résidentiel pouvaient cependant se limiter à la qualité du ciment sans exigences de résistance à la compression. Cependant dès 1920, une résistance de 2000 lb/po² (14 MPa) était une résistance facilement atteignable avec la technologie du temps. C’est cette résistance minimale de 14-15 MPa qui est requise par les codes de construction du bâtiment jusqu’à l’édition présente du Code national du bâtiment – Canada 2020 (lequel peut ne pas être référé dans votre municipalité). À partir de l’édition 2014 de la norme CSA A23.1 : Béton – Constituants et exécution des travaux, l’exigence de résistance pour le béton de fondation, d’une classe d’exposition R*, est de 25 MPa. Cette exigence n’est pas formellement intégrée au Code national du bâtiment 2015 et 2020.
Il faudra attendre le développement des entraîneurs d’air* dans les années 1940-50 pour pouvoir qualifier de durable le béton face aux cycles de gel et de dégel rapides. Des critères de teneurs en air et de caractéristiques du réseau de bulles d’air sont inclus à la norme CSA A23.1 dès l’édition de 1960. Le béton des fondations étant soumis à des cycles de gel et de dégel en condition non saturée, la décennie des années 1960 est par conséquent une période charnière pour la qualification du béton.
Les codes de construction du XXe siècle ont rapidement demandé une hydrofugation du béton des fondations; elles doivent être protégées contre l’humidité, ce qui est encore une exigence actuelle, et prévoir un drainage des fondations (Section 9.13 du Code national du bâtiment – Canada). L’hydrofugation ne vise cependant qu’à limiter le transport de l’humidité. Elle est obtenue par la pose d’une mince couche de goudron, avant les années 1960, ou de bitume par la suite.
Faire ou non une intervention
Un béton sans air entraîné n’est pas considéré durable en présence d’eau et de cycles de gel et de dégel. Toute intervention qui vise à diminuer l’eau dans le béton en augmentera sa longévité. Il n’y a pas d’intervention unique, considérant que la qualité actuelle du béton d’avant les années 1950 peut être très variable, souvent de très faible résistance, résultant des cycles de gel et dégel dans ce dernier, à 7 MPa, à 14 -15 MPa, à 40 MPa et même 60 MPa occasionnellement. Comme uniquement du ciment Portland était d’usage dans cette première demie du XXe siècle, la durabilité des bétons sans air entraîné est directement reliée à la porosité de la pâte du béton et donc directement reliée au rapport eau/ciment du mélange. L’autre cause principale de détérioration du béton jusqu’au milieu du XXe est reliée à une réaction entre les alcalis du ciment (sodium et potassium) et les granulats, causant ainsi une microfissuration que l’on nomme réaction alcalis-granulats (RAG). La réaction produit un gel calco-silico-alcalin communément appelé gel de silice. Dans une situation de cycles de gel et dégel pour un béton atteint de réactions alcalines, les désordres seront plus importants par l’ouverture de la microfissuration due à l’action du gel. Concernant le drainage des fondations au début du XXe siècle, on utilisait des drains de grès ou de terracotta qui pouvaient ne pas être perforés, appuyés les uns sur les autres, sans enrobage de pierre nette. Ce n’est qu’au début des années 1980 que le développement des géotextiles a permis la pose des drains de plastique perforés et enrobés de géotextile ou encore des drains de pierre nette enrobés par un géotextile. On considère, qu’avant l’utilisation des géotextiles, les drains devenaient probablement bouchés et non fonctionnels après 20 à 30 ans d’utilisation. |  |
 | |

Références
- AMCQ, Devis étanchéité des surfaces de béton, Division imperméabilisation, première édition, mai 2005.
- Conseil national de recherches Canada (CNRC), Code national du bâtiment – Canada, 2015 et 2020, accessible en ligne.
- Lafarge, Lafarge au Canada, 50 ans d’histoire, 1956-2006, Groupe Qualibris, décembre 2007, 221 pages.
Lexique
Classe d’exposition : La norme canadienne définie, sous des classes (C, F, N, S, R), des exigences de résistance, liant, rapport eau/liant, teneur en air et cure associés aux usages et aux types d’agression du béton : soumis aux sels - C, soumis à des cycles de gel et dégel - F, intérieur - N, attaque par les sulfates - S, résidentiel -R (semelle R-1, mur R-2, dalle intérieure R-3).
Clinker : Résultat, sous forme de boulettes, du chauffage à haute température (1450°C) d’un mélange soigneusement dosé de calcaire, silice, fer et aluminium, généralement dans un four rotatif.
Entraineur d’air : Ajouté en usine principalement sous forme liquide, lorsque bien dosé et validé, le volume d’air, la dimension et la distribution des bulles d’air permettent à l’eau contenue dans le béton d’y prendre expansion lorsque le béton gèle, prévenant la fissuration.
Hydrofugation : Action de limiter l’absorption d’eau du support, ici le béton. Par opposition, l’imperméabilisation requiert un système plus robuste pour rendre un élément étanche à l’eau.
Pouzzolanique : Matériau qui a la propriété, en présence d’eau et de chaux, de réagir avec l’eau et de former des hydrates liants (C-S-H). Tenant son nom d’une localité dans la Rome antique où elle était présente, la pozzolante, une pierre naturelle d’origine volcanique, était mélangée à de la chaux, ce qui permettait une prise des mortiers, même immergés.
Article tiré de La Lucarne – Automne 2024 (Vol XLV, numéro 4).
© APMAQ 2024. Tous droits réservés sur l’ensemble de cette page. On peut reproduire et citer de courts extraits du texte à la condition d’en indiquer l’auteur et la source, mais on doit adresser au secrétariat de l’APMAQ toute demande de reproduction de photos ou du texte intégral de cette page.
Retour


.png)